Un rapport secret commandé par Ecolo analyse la com du parti lors de la législature écoulée. Il dénonce notamment les «postures morales» trop souvent adoptées par les verts entre 2019 et 2024.
Avant la refondation du parti, avant le «printemps populaire» annoncée mardi 22 avril par les écologistes, mais après la double défaite électorale de juin et d’octobre, Ecolo a lancé cinq chantiers (un, le plus important, sur l’analyse du fonctionnement interne du parti, un sur l’enquête populaire réalisée dans le grand public, un sur les autres partis verts en Europe, un sur les rapports avec la société civile, et un sur la communication), qui ont fait l’objet d’autant de rapports secrets lors du conseil de fédération –le parlement interne d’Ecolo– du 22 mars dernier. Parmi ces cinq rapports confidentiels, «l’analyse communicationnelle de la défaite d’Ecolo 2019-2024» menée par Baptiste Erkes, conseiller chez Etopia, à partir d’une «vingtaine de rencontres d’experts et expertes de la communication politique, d’acteurs et actrices internes et externes de la communication d’Ecolo», se révèle particulièrement intéressante. D’autant plus que toutes les récentes sorties des coprésidents écologistes, du déjà célèbre «on a merdé» de Samuel Cogolati au «printemps populaire» lancé pour «redonner le pouvoir aux gens», semblent bien emprunter le chemin tracé tout le long de ces trente pages elles aussi ravageuses pour les années écoulées et la direction sortante, qui se concluent par douze «pistes pour l’avenir».
L’analyse confidentielle commence par un constat, et réclame qu’il soit dépassé: les verts n’aiment pas la com. «Pour beaucoup d’entre nous, la com politique, c’est quelque chose d’un peu « sale »: la communication, comme la publicité par exemple, ce serait travestir les faits», explique Baptiste Erkes à la page 4. Il faut, dit-il, en finir, parce que «nos adversaires, eux, ne s’en privent pas, et ont même parfaitement compris que nous avons du mal avec la communication».
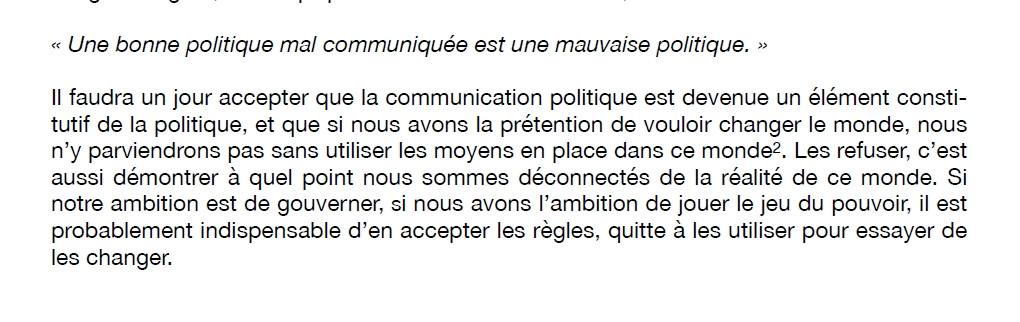
Ceci posé, l’analyse aborde les contextes externe et interne, tous deux défavorables à Ecolo à la fin de la législature, alors que le parti est à tous les niveaux de pouvoir et que «les compétences ministérielles qui vont être dévolues à nos ministres sont des matières traditionnellement « vertes », avec ce que cela compte d’opportunités mais aussi de risques». Après les crises du Covid et de l’Ukraine, «notre posture de la « vie plus chouette » devient intenable». Et, «véritable inversion orwellienne, les écologistes semblent devenir la cause de tous les tracas du monde».
La ligne politique verte, hostile intrinsèquement à la com, donc aux «coups», qui considère la communication comme la dernière chose à considérer dans la mise en œuvre d’une politique publique, témoigne selon le rapport d’un «dysfonctionnement structurel», et le travail des communicants verts, souvent «juniors» par manque de considération pour la discipline, en est devenu pratiquement impossible. «Cela pouvait aller de la « mauvaise punchline » imposée à la couleur discutable d’une chemise avant un passage télé ou du vocabulaire obscur utilisé pour des posts Facebook.»
«Les ministres ont manqué de charisme»
Le choix des ministres aux différents niveaux de pouvoir, «sans prise en compte des compétences communicationnelles», témoigne de cette erreur fondatrice. «Nos représentants, dans leur grande majorité, bien que compétents, ont manqué de charisme, de chaleur, d’empathie, de proximité. Ils et elles ont souvent donné l’image de techniciens compétents mais déconnectés, quand ils n’étaient pas perçus comme arrogants», dit-on page onze. Les commentaires choisis pour illustrer le propos sont remarquables de cruauté.
Résultat, «un manque de charisme, une priorité excessive à l’expertise, une multiplication des personnalités mises en avant et des problèmes spécifiques avec certaines figures, notamment sur des questions de loyauté ou de comportements cyniquement individualistes sont pointés du doigt comme ayant contribué aux difficultés de communication, à l’image globale d’Ecolo et potentiellement aux résultats électoraux décevants».
Plus fondamentalement, la ligne politique du parti, traduite par cette communication défaillante, a, selon le rapport, déforcé Ecolo à deux égards. D’une part en ouvrant des débats sur des thématiques plus éloignées de l’essence écologiste, et d’autre part en ancrant trop visiblement les verts à la gauche de l’échiquier politique. Cette ligne, ce réflexe même, a surtout consisté à se focaliser sur sa base militante et pas sur son électorat, réel ou potentiel. «Des thématiques, importantes, (LGBTQI, décolonialisme, Gaza…) ont été abordées sous un prisme perçu comme radical, déstabilisant pour une partie de notre électorat et aisément instrumentalisable par nos adversaires. Cela pose un problème de positionnement: avons-nous fait de la politique pour nos militants, par définition plus radicaux et engagés plutôt que pour nos électeurs?». «Ecolo a souvent communiqué pour Ecolo, s’adressant à ses propres cercles plutôt qu’au grand public.»
Pour les communicants, ce «manque de direction politique claire», qui laissait, aux dires du rapport, trop d’espace aux postures plus radicales, ont marqué «une difficulté à gérer l’influence des éléments plus radicaux du parti, notamment sur les questions de société ou d’identité». Ces communicants, qui ont été dirigés en cinq ans par quatre directeurs du département communication (DCOM) différents, ont donc travaillé dans les pires conditions possibles.
L’écriture inclusive et les Schtroumpfs à lunettes
«Le langage et la tonalité employés par les écologistes constituent des obstacles majeurs à l’élargissement de notre audience», poursuit Baptiste Erkes, qui déplore une communication «perçue comme professorale». «A titre d’exemple, l’écriture inclusive, bien qu’en phase avec nos valeurs, peut aussi être perçue comme excluante lorsqu’elle va au-delà des recommandations de la FWB et introduit des mots inconnus d’une large part du grand public (« toustes », « iels », « celleux »,…).»
C’est le fameux air de Schtroumpf à lunettes que l’on attribue volontiers aux écolos. «Pire, cette posture professorale est parfois ressentie comme moralisatrice et condescendante. Certaines postures semblent condamner moralement toute personne qui oserait être moins radicale que nous. Et lorsque nos arguments ne convainquent pas, nous les répétons en supposant que notre interlocuteur ou interlocutrice a mal compris ou finira par comprendre, ce qui donne l’impression que nous le prenons pour un idiot.»
La communication digitale, pourtant centrale aujourd’hui, a subi les conséquences des erreurs stratégiques qui précèdent. Sans ligne claire, elle est partie dans tous les sens, «là où les autres partis martèlent 50 fois le même message, les écologistes préfèrent poster une seule fois 50 messages différents, souvent avec des formulations complexes, variables qui brouillent encore plus l’identification». Cadenassée par une éthique dépassée par l’époque, elle s’est refusée à sponsoriser des publications. Et le recrutement, orienté prioritairement sur les cabinets et sur des profils classiques, a manqué d’opportunité. «Les choix éditoriaux sont aussi questionnés: une surreprésentation de certaines thématiques (LGBTQIA+, Gaza, etc.), au détriment d’autres sujets plus généraux, a pu donner une impression de communication biaisée et de niche, parlant davantage aux convaincus qu’au grand public. Certaines figures internes ont été systématiquement mises en avant, tandis que d’autres étaient marginalisées sans justification claire, ce qui a renforcé les ressentiments, suscitant en retour un manque de collectif et de cohésion», est-il expliqué page 21.
Quant aux relations d’Ecolo avec la presse et les médias traditionnels, elles se seraient progressivement dégradées. D’abord parce qu’il est plus facile d’obtenir «de bons papiers» quand on est dans l’opposition que lorsqu’on est au pouvoir, dit un intervenant. Ensuite parce que, le casting ayant été ce qu’il a été, les ministres verts manquaient «de sexytude», et n’étaient pas «de bons clients» pour les médias: «des revirements politiques difficilement explicables, du contenu bâclé, des postures intenables ont pu nuire à la crédibilité du parti auprès des journalistes». Enfin, la pression d’autres acteurs, un en particulier, a spécialement coûté aux écologistes, «même si elle est jugée particulièrement sale». «Une victoire de la bataille culturelle menée par Bouchez est aussi d’avoir réussi à faire croire que tous les médias et les journalistes sont de gauche, les obligeant plus ou moins consciemment à droitiser leurs pratiques en réaction…»
Les coprésidents deviendront youtubeurs
Enfin, les pistes tracées qui, on le répète, semblent avoir fort attiré l’attention des coprésidents Samuel Cogolati et Marie Lecocq, sont présentées par Baptiste Erkes avec une structuration duodécimaine. Voici le dodécalogue de la future com Ecolo.
1. Définir la place de la communication dans la politique. Ce qui implique notamment d’oser «adopter une approche plus managériale en matière de communication», et de veiller à recruter et à valoriser des profils plus «seniors».
2. Se baser sur une ligne politique claire.
3. Une communication s’adresse à toutes et tous. Il faudrait, dit le rapport secret, «sortir de « Ecolo parle d’Ecolo à Ecolo » et arrêter de nous regarder le nombril».
4. Un casting resserré. Il est essentiel, ajoute Baptiste Erkes, «de recentrer notre communication autour de figures fortes, légitimes et incarnées plutôt que de multiplier les personnes qui prennent la parole au nom du parti». Pour cette raison, ces figures «devront accepter de devenir youtubeurs/youtubeuses/influenceurs/influenceuses avec une conduite et une mise en scène de soi forte, théâtralisée, et soutenue collectivement». Même si cela risque de «crisper en interne».
5. Jouer beaucoup plus collectif. En tout cas pour les mandataires et militants qui ne se seront pas transformés en youtubeurs/youtubeuses incarnant le parti.
6. Un département communication central, qui coordonne et orchestre.
7. Un résilience quand le contexte échappe au parti.
8. Se fixer une ligne par rapport aux questions éthiques. Le rapport aborde là le rapport aux nouvelles technologies, notamment lorsqu’elles imposent de récolter des données ou de financer des multinationales. Mais il porte aussi sur les nouvelles manières de faire de la politique. «Les faits ne suffisent pas. Nous devons donc embrasser pleinement les nouvelles dynamiques de communication» et «simplifier nos messages, adapter nos formats et travailler nos narrations pour les rendre accessibles et percutantes».
9. Faire appel à des aides professionnelles externes quand c’est nécessaire.
10. Une formation continue en communication pour les militants, cadres et mandataires.
11. La communication digitale au cœur de tout.
12. Une reconstruction stratégique des relations avec la presse. Celle-ci demandera «en parallèle un travail d’identification de la pléthore de nouvelles actrices et nouveaux acteurs journalistiques en ligne, influenceurs et influenceuses, et créer des contacts avec elles et eux».
Ainsi se conclut l’analyse communicationnelle de la défaite écologiste. Elle est grosse de pistes, et ses perspectives, l’actualité des dernières semaines le démontre, sont suivies par les deux jeunes patrons écologistes.




